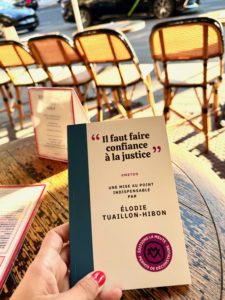Pour reprendre le cours de ce blog délaissé durant de longs mois (occupations professionnelles très intenses au soutien d’un service public en déshérence, faut-il vraiment le préciser…), j’ai choisi de raconter une belle rencontre avec ma consoeur Elodie TUAILLON-HIBON, avocate engagée, militante et d’une si grande générosité au soutien des femmes et des enfants victimes de violences sexuelles. Assise en terrasse avec un café, sous les rayons déjà chauds d’un soleil matutinal, amie du lever-tôt, je l’attendais avec impatience.
Je la suivais depuis longtemps, je voyais en elle la force de ces femmes libres, parfois mélancoliques, portant avec dignité un combat difficile, tant décrié souvent incompris, je me suis dit qu’elle aussi, elle avait dû voir la série Sambre et se reconnaître dans chacun des personnages: comment réveiller les consciences? Comment vaincre l’injustice? Comme secouer le système? Comment ne plus s’agacer des discours nauséabonds sur l’engagement, le mouvement #metoo, le mépris, la haine parfois, face à un phénomène de société de plus en plus incontestable? J’ai admiré sa constance, sachant le prix à payer d’un tel engagement et puis j’ai vu qu’elle avait écrit, en parallèle de son activité de recherche et d’avocate (wonderwoman!), un petit pamphlet au titre aguicheur:
« Il faut faire confiance à la justice »
En tant qu’auxiliaire de justice évidemment, on mesure l’immédiat cynisme et la provocation de ce titre: pourquoi continuer le métier d’avocate si, en toute objectivité parfois, on a renoncé à croire que la justice pouvait changer les choses? Et, en toute objectivité vraiment, il y a de quoi être sévèrement critique face au flot d’actualité en lien avec le patriarcat et les « stars » du showbiz ou de la politique mis en cause dans des histoires particulièrement sinistres. Pour les anonymes? Il aura fallu des procès hors norme comme ceux de Dominique Pélicot ou de Joël le Scouarnec. Les violences sexuelles n’ont pas de classe: il ne s’agirait pas d’en faire l’élément dramaturgique d’une vie publique mais bien d’analyser le système, en profondeur, qui s’y révèle. Dans une société spectacle, on se préoccupe de porter aux nues l’acteur ou l’élu avec ses frasques, en oubliant qu’il y a derrière des mécanismes graves qui se retrouvent dans le couloir d’une entreprise, dans la cave d’une maison, chez le voisin et ami très gentil, dans les mains d’un oncle, dans le coup d’un meilleur ami.
C’est bien tout ce paradoxe qui inspire cet écrit engagé et j’y ai lu, au-delà du cynisme, à la fois le désespoir, la force et le courage. J’y ai aussi découvert un travail incroyable de pédagogie là où la colère doit parfois tant habiter l’autrice, l’effort du discours audible en dehors de toute démonstration partisane, polarisée ou idéologique, le constat de faire avec les moyens du bord, une analyse humble et critique du système et puis surtout, quelques lueurs faibles mais constantes d’espoir. J’y ai lu à la fois le découragement, la fatigue, l’usure mais aussi cette force incroyable que l’on ne voit que chez les acharnés des droits humains: l’espoir, oui, l’utopie peut-être, cette chose au fond de soi qui fait que non, malgré tout, on ne renoncera pas. Parce que l’on ne peut pas se résigner. A en mourir peut-être, mais tâchons de l’éviter, c’est un peu ce cri là qui ressort de chaque ligne.
Pourquoi tout le monde doit lire ce livre?
Ce n’est pas un nouvel essai féministe qui tente de convaincre en portant une voix qui se perdra, souvent, parmi les autres, dans les grands couloirs, au mieux de l’indifférence, au pire du mépris. C’est une voix empreinte à la fois d’humanité et de désespoir, d’humilité et de détermination, qui tente, avec pédagogie, de déclarer son amour à la justice, à celle qui se préparera, se formera et entendra. Elodie TUAILLON-HIBON y couvre tous les sujets, elle répond à toutes les questions et anticipe avec bienveillance tous les discours haineux ou les réponses à formuler aux oncles, cousins et autres parents dans les dîners de famille ou encore, ne les oublions pas, à ces femmes traditionnalistes.
Elle tente avec objectivité d’ouvrir les consciences et elle fait sa part, avec beaucoup de générosité.
Mais que faut-il maitriser son sujet pour le restituer avec autant de clarté et d’évidence! Que faut-il aimer son métier pour livrer, avec générosité, sa force et son désespoir en appelant à une immense humanité collective! Je suis touchée et je me dis que c’est là, dans ces gestes qui en disent et donnent beaucoup, que se niche la réalité de nos utopies collectives.
Pas de blabla: de l’action. Tous les jours, tout le temps. Une avocate, une vraie.
Elodie TUAILLON-HIBON le dit, avocate des causes de genre, « on investit beaucoup d’énergie et de temps dans des contentieux qui ne fonctionnent pas ou très mal, on peut perdre le sens de ce qu’on fait – outre qu’on y laisse souvent sa santé et qu’on y gagne généralement mal sa vie. » (Page 14) Faut-il le rappeler? Victimes ou défenseurs, la question n’est jamais celle de l’argent mais de la dignité. Elle souligne par ailleurs combien le public connaît mal toutes les voies procédurales possibles tant les émissions de téléréalité ou de fait divers, la presse aussi disons-le, feuilletonnent sur les procédures pénales, violentes, pleines de drame, de sang et de larme, en oubliant qu’il existe tant d’autres voies possibles.
Elle y décrit aussi une justice de classe, reflétant imparfaitement la société, manquant de moyens mais aussi et surtout de formation technique. Le viol, notamment, est comme beaucoup d’autres infractions, un univers qui s’apprend au-delà de la définition légale: en contextualisant une situation, ce qui en fait, comme le harcèlement moral d’ailleurs, des situations qui nécessitent du temps, de l’investissement et beaucoup beaucoup d’humanisme. Car aux frontières du droit, il y a l’éthique.
Et puis parlons du mot « victime »: Elodie TUAILLON-HIBON l’aborde un peu, je crois que cela mériterait même un ouvrage à part entière… cette laissée pour compte de la procédure, cet animal sauvage à brûler sur un bûcher, cette chose narcissique qui oscille entre pleurnicherie et érotisation, qui veut absolument exister. Une vraie définition à réinventer mais probablement pas, et je rejoins son analyse, dans les modes alternatifs de résolution des litiges, lorsque la procédure le permet. La justice ne saurait se défausser parce qu’elle est débordée, insuffisamment pourvue et fragilisée, au profit d’un système parallèle qui, malheureusement, reproduit souvent les mécaniques de domination dénoncées.
Y a-t-il un lien d’ailleurs entre l’ultra féminisation des métiers de justice et l’identité d’une femme?
Elodie TUAILLON-HIBON fait un constat dur mais réel, après analyse des données chiffrées, rares, que l’on peut avoir sur le sujet: « cette réalité, c’est qu’il y a beaucoup trop de victimes, mineures et majeures, de violences sexuelles chaque année. Que la grande majorité des auteurs de ces violences sont des hommes. Que trop peu de ces victimes portent plainte, encore moins dans les jours qui suivent les faits (pour diverses raisons, dont une bonne part, nous le verrons, tient au fonctionnement et à la réputation méritée de la justice sur ce sujet). Que les parquets ordonnent bien trop de classements sans suite « faute de preuves suffisantes », à l’issue d’enquêtes encore trop souvent mal faites ou incomplètes. Que trop peu de juges d’instruction sont saisis. Que trop d’ordonnances de non-lieu sont rendues. Que trop peu d’agresseurs sont condamnés. » (Page 35)
Le chiffre le plus parlant est probablement le chiffre noir, celui des plaintes jamais déposées: « honte et sentiment de culpabilité, parcours judiciaire angoissant, rapports difficiles avec la justice ou inexistants avec les institutions, âge des victimes, difficulté à comprendre qu’il s’agit d’un viol, manque d’information et de visibilité sur les procédures disponibles…la liste est longue. » (Page 37)
La prévention? « Échec ou dysfonctionnement si on est technocrate, trahison si on est une victime (ou son avocate). » (Page 38)
N’oublions pas le chapitre qui parlera à toutes les femmes, je dis bien toutes: « notre petit tribunal intérieur« , celui par lequel toute femme réalise, mêmes les plus conservatrices, à quel point nous apprenons à nous protéger des agressions et des situations de risque de viol, tous les jours, au quotidien, au point de culpabiliser si le risque venait à se réaliser. Car il est rappelé que le problème n’est pas le nombre d’unités d’alcool ingérées ou l’heure à laquelle on est rentré. Le problème c’est de continuer d’accepter que certains hommes sont des prédateurs, le problème c’est le risque de viol, l’atteinte à l’intégrité de la personne. Et l’actualité nous montre que ce risque touche absolument tous les milieux, du « berceau de la domination » – la famille – au travail, à la rue, aux institutions, à la fiction.
Les conséquences? L’invisibilisation.
De nouveaux termes, glaçants, sont apparus: attentat masculiniste, contrôle coercitif, sidération…la société prend lentement conscience de l’ampleur du phénomène mais il paraît si fou qu’il reste encore trop largement inaudible. Derrière ces fonctionnements et dysfonctionnements de justice évidemment, des phénomènes de société qui ont offert encore plus d’opportunités aux prédateurs: les réseaux sociaux, la vidéo, les mises en réseau, le choix infini et le misérabilisme affectif. En témoignent d’ailleurs la récente affaire du faux Brad Pitt, la prostitution des adolescentes ou encore la marchandisation du sentiment par les réseaux de rencontre, temple de la manipulation des solitudes modernes.
Alors l’autrice nous offre une belle solution, que l’on ne peut que partager: refaire humanité. Ça commence par offrir ce livre à vos copines réfractaires ou endormies, à vos frères, votre meilleur copain, à votre compagnon aussi, à des jeunes femmes pour l’espoir, à de jeunes (et moins jeunes) hommes pour comprendre, à tout le monde en fait, laissez-le trainer sur un coin de table dans vos familles, ouvrez les discussions et regardez objectivement.
Parce que si les hommes faisaient le moindre sondage autour d’eux, à interroger leurs filles, femmes, sœurs, cousines, patronnes, subalternes, si la parole des enfants était consacrée…les vrais chiffres, eux, feraient vraiment froid dans le dos.
Bravo à l’autrice pour la force de son engagement, on mesure peu le courage qu’il faut pour tenir tête, avancer et ne pas se résigner.
« Il faut faire confiance à la justice » de Elodie TUAILLON-HIBON, éditions La Meute, mars 2025